Boursorama le 27/04/2007 10h50
Anton Brender : « Les capacités d’endettement des ménages sont saturées »
Avec 800 milliards de dollars de déficit extérieur courant, les Américains sont-ils assis sur une bombe à retardement ? Anton Brender, directeur des études économiques chez Dexia AM, écarte tout catastrophisme. Mais la capacité de résilience de l’économie américaine a atteint une limite. Si bien qu’en cas de nouveau choc pétrolier, l’airbag américain ne se gonflera plus.
Quelle est la configuration actuelle des déséquilibres financiers globaux ?
Anton Brender : On observe depuis la fin des années 90 une configuration très déséquilibrée des paiements internationaux. Les transferts d’épargne s’orientent vers les régions les plus développées, dotées de systèmes financiers capables d’absorber l’excédent d’épargne des pays émergents (Asie) et des pays producteurs de pétrole. Le Sud prête au Nord. Cette orientation des flux résulte de l’absence de canaux financiers permettant d’acheminer les capitaux vers les régions qui en manquent le plus. Ceci a conduit à une concentration de l’endettement sur un petit nombre de pays dont, essentiellement, les Etats-Unis. Ces derniers ont emprunté plus de 800 milliards de dollars en 2005 (6,4% du PIB) contre à peine plus de 100 milliards dix ans plus tôt. Le Japon a dégagé un excédent de 160 milliards de dollars, l’Asie émergente de 240 milliards et les pays exportateurs de pétrole de 350 milliards (OPEP et Russie).
En se finançant auprès du reste du monde, les Américains ont-ils mis en place un modèle puissant de croissance ?
A. B : Il faut voir ce système comme un élément de régulation de la demande et non comme un élément de soutien de la demande, moteur de croissance. Là où dans le monde se forment des pressions inflationnistes et un excès d’épargne, il faut qu’il y ait ailleurs un besoin d’emprunt. Les Etats-Unis ont assumé ce rôle en mettant en place des canaux qui permettent aussi bien d’accélérer l’endettement que de le freiner. Grâce à un système financier efficace, la baisse des taux directeurs de la banque centrale américaine a effectivement incité les ménages à s’endetter. De la sorte, les pressions déflationnistes de l’économie mondiale ont été absorbées grâce à l’endettement de quelques pays occidentaux (Etats-Unis, Australie, Nouvelle Zélande, Espagne. Ce type de mécanisme demande néanmoins une surveillance attentive.
Pourquoi la zone euro n’a t-elle pas pu non plus profiter de ces mécanismes d’endettement ?
A. B : Au niveau de la zone euro, il existe une relative faiblesse de l’intégration bancaire. L’unification financière s’est arrêtée au marché, celle de la banque de détail et des produits d’emprunts n’étant pas jugée prioritaire. Les petites entreprises locales et les ménages ne bénéficient pas de la concurrence entre les banques de détail européennes. Les conditions d’endettement (produits d’emprunt différents) et « l’envie de prêter » ne sont pas les mêmes. Par exemple, on remarque que la transmission de la baisse des taux de la BCE après 2000 a été faible et inégale selon les Etats européens. L’Espagne a nettement creusé son déficit alors que les pays scandinaves et l’Allemagne ont vu leur excédent s’accroître.
Jusqu’à quand les Etats-Unis pourront-ils continuer d’accumuler des dettes vis-à-vis du reste du monde ?
A. B : Nous pensons que le maintien des mécanismes d’endettement ne sera pas mis en cause par une pression des créanciers extérieurs. Le problème de « soutenabilité » des déficits des Etats-Unis prend deux formes : un risque monétaire et un risque financier. Au premier risque - le reste du monde acceptera t-il de détenir des actifs en dollars sans baisse profonde de la devise ? - nous estimons que la globalisation financière a fortement réduit la pression à la baisse du change en accroissant la taille des portefeuilles d’actifs internationaux. De plus, le rôle de la spéculation est le plus souvent stabilisateur. A la seconde question - pourra t-on longtemps prêter aux débiteurs américains, dans quelque monnaie que ce soit ? - nous pensons que cette contrainte extérieure a peu de chance d’apparaître. La solvabilité des résidents dont le bilan sert de support aux entrées de capitaux extérieurs est loin de pouvoir inquiéter. Les entreprises non financières ont fait depuis 2001 un gros effort d’assainnissement financier, les banques sont redevenues prospères et sont parmi les mieux dotées en capitaux propres et l’Etat fédéral a un endettement public (rapporté au PIB) comparable à celui de la moyenne des Etats européens.
Quel sera alors le frein au déficit extérieur américain ? Comment peut-il être réduit?
A. B : La dérive récente des déficits reflète surtout un endettement accru des ménages, leur solvabilité pose question. Fin 2006, cet endettement était soutenable parce que la plus grande partie des ménages a réalisé des dépenses de biens durables (immobilier) avancés sur des revenus à venir. Or, les capacités d’endettement des ménages sont maintenant saturées. Le rééquilibrage de la position extérieure des Etats-Unis se réalisera de l’intérieur par un atterrissage en douceur de l’économie (augmentation du loyer de l’argent associée à la hausse du prix de l’immobilier. Mais ce ralentissement ne sera pas suffisant pour réduire l’endettement sans un maintien du plein-emploi. Cet objectif n’est réalisable que si la demande extérieure prend le relais de la baisse de la croissance de la demande privée. Une baisse du change effectif du dollar est donc nécessaire.
L’économie américaine a atteint aujourd’hui la limite de sa capacité d’endettement. Pourra t-elle supporter d’autres chocs ?
A. B : En attendant que les ménages américains reconstituent leur marge d’endettement, la capacité de l’économie américaine a absorbé des chocs déflationnistes s’est considérablement rétrécie. S’il n’y a pas d’autres pays qui développent des capacités d’endettement du même type, l’économie mondiale sera plus vulnérable au choc déflationniste. Une nouvelle hausse du prix du pétrole n’aura pas du tout les mêmes conséquences que celles que nous venons de connaître. Au lieu d’être absorbé par un surcroît d’endettement des ménages américains, l’ajustement pourrait se réaliser par la baisse de l’activité donc par une récession. Dans cette perspective, un bras de fer entre autorités monétaires sur le cours des monnaies déstabiliserait la zone euro qui est très mal équipée pour soutenir sa monnaie. En l’absence de politique commune en direction du plein emploi et d’une meilleure intégration bancaire permettant la convergence des conditions d’endettement, la zone euro subirait de plein fouet la baisse organisée du dollar.
29 avril 2007
12 décembre 2006
Une étude intéressante du XERFI sur l'évolution de l'immobilier
Un krach immobilier ?... "-25% d'ici 2010" selon une étude du XERFI (études de marché) dans sa newsletter économique gratuite (voir les arguments et stats, pdf page 7):
http://195.154.196.88/sitexerfi/DERNIER_NUMERO.pdf
vu sur http://www.xerfi.fr/
repris dans un article du Figaro :
http://bourse.lefigaro.fr/Actualite/Default.asp?Source=FI&NumArticle=60935
http://195.154.196.88/sitexerfi/DERNIER_NUMERO.pdf
vu sur http://www.xerfi.fr/
repris dans un article du Figaro :
http://bourse.lefigaro.fr/Actualite/Default.asp?Source=FI&NumArticle=60935
04 décembre 2006
Le capital investissement ou "private equity" et le non coté
Grégoire Sentilhes (Aurel NextStage) : " Le non coté permet d'échapper aux évolutions brutales des marchés boursiers " (29/11/06)
Au-delà des FCPI et des FIP, à l'honneur en fin d'année grâce à leurs avantages fiscaux, le développement des investissements dans les entreprises non cotées sur un marché réglementé ouvre la voie à de nouveaux types de placements.
Les investissements dans des entreprises non cotées se développent en France depuis une petite dizaine d'années. Pourtant, en dehors des FCPI et FIP qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt, ces investissements sont souvent ignorés des investisseurs alors qu'ils peuvent leur permettre une performance supérieure et décorrélée du marché boursier.
Entretien avec Grégoire Sentihles, Président du directoire d'Aurel NextStage, société spécialisée dans le domaine du non coté.
Comment définiriez-vous le "private equity" ?
"Private equity" est le terme anglais pour désigner le "capital investissement". Le métier du capital investissement, qui est en plein essor depuis 30 ans aux Etats-Unis, et depuis 10 ans en France, consiste à investir en fonds propres dans le capital d'une société non cotée.
Quelles ont été au cours des années passées les performances du "private equity" et les niveaux de risques rencontrés par les investisseurs ?
Selon les stades de développement de l'entreprise dans laquelle on investit, il importe de rappeler que la notion de capital investissement recouvre plusieurs métiers :
1. Le capital risque.
Il s'agit de financer et d'accompagner la création d'entreprises ou de financer de nouvelles technologies. Ce métier a attiré quelque 481 millions d'euros en 2005 contre 396 millions en 2004. Il représente 8 % du marché. La performance annuelle moyenne sur 10 ans est de 5% (source AFIC et Ernst & Young). Dans les bonnes années 1999-2000, les performances ont atteint, voire dépassé pour les meilleurs fonds, les 25% de taux de rendement interne annuel. Le potentiel est élevé mais la prise de risque également, principalement due à une absence de liquidité pendant une période de 8 ans. Les dispersions de performances entres les investissements, mais aussi entre les acteurs sont importantes.
2. Le capital développement
permet d'injecter des capitaux dans une entreprise déjà rentable pour permettre sa croissance. Il s'agit du segment où les opportunités sont les plus nombreuses même s'il ne représente que 35% du nombre total des investissements et 10% des capitaux investis. Ce secteur a drainé quelque 954 millions d'euros en 2005 pour 425 entreprises et génère des taux de rendements internes moyens sur 10 ans de 15 à 18% (source AFIC et E&Y). Ce segment offre en fonction des styles de gestion un profil de risque plus faible.
3. Le capital transmission
, ou LBO s'applique à la passation de pouvoirs de l'entreprise. C'est le segment, aujourd'hui, le plus important du capital investissement, par le nombre d'acteurs et la taille des opérations, avec 6,287 milliards d'euros investis (progression en nombre de 70,5% en 2005 et de 78% des montants investis). Ceci est dû, notamment, aux taux d'intérêt bas depuis 10 ans. Il génère des taux de rendements internes moyens sur 10 ans de 23 à 25 % (source AFIC et E&Y). La prise de risque peut être importante, notamment en fonction du montant de la dette engagée (effet de levier).
Comment le "private equity" est-il accessible aux petits porteurs ?
Les outils utilisés par les professionnels du secteur sont les FCPR, ou fonds de placements à risque, à destination des grandes institutions financières et des grandes fortunes qui investissent entre 500.000 euros et 100 millions d'euros. Les particuliers ont, eux, accès aux FCPI, ou fonds de placement dans l'innovation, et aux FIP, ou fonds d'investissement de proximité, qui sont accessibles à partir de 3.000 euros.
Soulignons que des sociétés de gestion, comme Aurel NextStage, développent en parallèle des FCPR ainsi que des FCPI et FIP. Ces deux derniers outils sont dotés d'importants avantages fiscaux similaires, et qui peuvent être additionnés.
En France, la collecte réalisée au titre des FCPI s'est élevée à 535 millions d'euros en 2005 contre 360 millions d'euros en 2004. Les FIP, de création plus récente, ont collecté 130 millions d'euros en 2005 pour leur troisième année, contre quelque 80 millions d'euros l'année précédente. Les investisseurs particuliers ont accès à ces produits principalement, par l'intermédiaire de leurs conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, réseaux bancaires et assurances traditionnels.
Quelles sont les enveloppes fiscales proposées ?
Les FCPI et FIP sont les seuls produits de placement offrant, à la fois, un avantage fiscal à l'entrée et à la sortie. A l'entrée, le souscripteur bénéficie d'une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25% de sa mise, plafonnée à 12.000 euros pour un célibataire et à 24.000 euros pour un couple.
Mais ces avantages sont cumulables, un couple pouvant, ainsi, réduire sa facture fiscale de 12.000 euros !
A la sortie, les plus-values réalisées sont aussi exonérées fiscalement, hors prélèvements sociaux évidemment, et ce sans plafond de montant.
Une précision : la contrepartie de ces avantages est la durée de blocage des fonds. En effet, l'investissement dans le non coté nécessite du temps, ce qui explique que la durée de vie d'un FCPI ou FIP soit en général de 8 ans.
Le "private equity" permet-il d'avoir une gestion plus stable dans le temps ?
Il faut souligner, en effet, que les fonds dédiés au non coté permettent d'échapper aux évolutions parfois brutales des marchés boursiers où d'autres classes d'actifs (immobilier, matières premières...).
D'où l'antienne, répétée à l'envi, que FCPI et FIP constituent des outils de diversification du portefeuille, sur une classe d'actif structurellement sous-représentée dans le portefeuille des Français ; en effet les PME représentent près de 65% de l'économie hexagonale, mais moins de 1% des actifs détenus dans le portefeuille des Français.
En quoi se distinguent les FCPI et FIP d'Aurel NextStage ?
Deux points sont à souligner sur nos fonds.
Nous pratiquons le co-investissement entre nos FCPI-FIP et nos FCPR. Ceci veut dire que les particuliers qui investissent dans nos fonds ont accès aux mêmes dossiers d'investissement que les grands investisseurs institutionnels.
Par ailleurs, nous ne proposons que des fonds purs, c'est-à-dire entièrement dédiés à l'investissement dans les PME françaises, principalement non cotées ou cotées sur des marchés dédiés (Marché libre ou Alternext), y compris pour la partie d'investissement libre.
Nous avons une forte conviction sur l'intérêt de cette classe d'actifs pour les investisseurs et ne voulons pas " brouiller " l'intérêt de nos produits en mettant dans nos fonds des OPCVM ou de l'immobilier, déjà très présents dans le portefeuille des français. Ce positionnement nous permet de prendre du recul par rapport à l'optique purement fiscale pour valoriser au mieux et tout au long de l'année ces fonds comme des outils de placements performants.
Propos recueillis par Bernard Le Court
http://www.lesechos.fr/patrimoine/bourse/300118875.htm
Au-delà des FCPI et des FIP, à l'honneur en fin d'année grâce à leurs avantages fiscaux, le développement des investissements dans les entreprises non cotées sur un marché réglementé ouvre la voie à de nouveaux types de placements.
Les investissements dans des entreprises non cotées se développent en France depuis une petite dizaine d'années. Pourtant, en dehors des FCPI et FIP qui permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt, ces investissements sont souvent ignorés des investisseurs alors qu'ils peuvent leur permettre une performance supérieure et décorrélée du marché boursier.
Entretien avec Grégoire Sentihles, Président du directoire d'Aurel NextStage, société spécialisée dans le domaine du non coté.
Comment définiriez-vous le "private equity" ?
"Private equity" est le terme anglais pour désigner le "capital investissement". Le métier du capital investissement, qui est en plein essor depuis 30 ans aux Etats-Unis, et depuis 10 ans en France, consiste à investir en fonds propres dans le capital d'une société non cotée.
Quelles ont été au cours des années passées les performances du "private equity" et les niveaux de risques rencontrés par les investisseurs ?
Selon les stades de développement de l'entreprise dans laquelle on investit, il importe de rappeler que la notion de capital investissement recouvre plusieurs métiers :
1. Le capital risque.
Il s'agit de financer et d'accompagner la création d'entreprises ou de financer de nouvelles technologies. Ce métier a attiré quelque 481 millions d'euros en 2005 contre 396 millions en 2004. Il représente 8 % du marché. La performance annuelle moyenne sur 10 ans est de 5% (source AFIC et Ernst & Young). Dans les bonnes années 1999-2000, les performances ont atteint, voire dépassé pour les meilleurs fonds, les 25% de taux de rendement interne annuel. Le potentiel est élevé mais la prise de risque également, principalement due à une absence de liquidité pendant une période de 8 ans. Les dispersions de performances entres les investissements, mais aussi entre les acteurs sont importantes.
2. Le capital développement
permet d'injecter des capitaux dans une entreprise déjà rentable pour permettre sa croissance. Il s'agit du segment où les opportunités sont les plus nombreuses même s'il ne représente que 35% du nombre total des investissements et 10% des capitaux investis. Ce secteur a drainé quelque 954 millions d'euros en 2005 pour 425 entreprises et génère des taux de rendements internes moyens sur 10 ans de 15 à 18% (source AFIC et E&Y). Ce segment offre en fonction des styles de gestion un profil de risque plus faible.
3. Le capital transmission
, ou LBO s'applique à la passation de pouvoirs de l'entreprise. C'est le segment, aujourd'hui, le plus important du capital investissement, par le nombre d'acteurs et la taille des opérations, avec 6,287 milliards d'euros investis (progression en nombre de 70,5% en 2005 et de 78% des montants investis). Ceci est dû, notamment, aux taux d'intérêt bas depuis 10 ans. Il génère des taux de rendements internes moyens sur 10 ans de 23 à 25 % (source AFIC et E&Y). La prise de risque peut être importante, notamment en fonction du montant de la dette engagée (effet de levier).
Comment le "private equity" est-il accessible aux petits porteurs ?
Les outils utilisés par les professionnels du secteur sont les FCPR, ou fonds de placements à risque, à destination des grandes institutions financières et des grandes fortunes qui investissent entre 500.000 euros et 100 millions d'euros. Les particuliers ont, eux, accès aux FCPI, ou fonds de placement dans l'innovation, et aux FIP, ou fonds d'investissement de proximité, qui sont accessibles à partir de 3.000 euros.
Soulignons que des sociétés de gestion, comme Aurel NextStage, développent en parallèle des FCPR ainsi que des FCPI et FIP. Ces deux derniers outils sont dotés d'importants avantages fiscaux similaires, et qui peuvent être additionnés.
En France, la collecte réalisée au titre des FCPI s'est élevée à 535 millions d'euros en 2005 contre 360 millions d'euros en 2004. Les FIP, de création plus récente, ont collecté 130 millions d'euros en 2005 pour leur troisième année, contre quelque 80 millions d'euros l'année précédente. Les investisseurs particuliers ont accès à ces produits principalement, par l'intermédiaire de leurs conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, réseaux bancaires et assurances traditionnels.
Quelles sont les enveloppes fiscales proposées ?
Les FCPI et FIP sont les seuls produits de placement offrant, à la fois, un avantage fiscal à l'entrée et à la sortie. A l'entrée, le souscripteur bénéficie d'une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25% de sa mise, plafonnée à 12.000 euros pour un célibataire et à 24.000 euros pour un couple.
Mais ces avantages sont cumulables, un couple pouvant, ainsi, réduire sa facture fiscale de 12.000 euros !
A la sortie, les plus-values réalisées sont aussi exonérées fiscalement, hors prélèvements sociaux évidemment, et ce sans plafond de montant.
Une précision : la contrepartie de ces avantages est la durée de blocage des fonds. En effet, l'investissement dans le non coté nécessite du temps, ce qui explique que la durée de vie d'un FCPI ou FIP soit en général de 8 ans.
Le "private equity" permet-il d'avoir une gestion plus stable dans le temps ?
Il faut souligner, en effet, que les fonds dédiés au non coté permettent d'échapper aux évolutions parfois brutales des marchés boursiers où d'autres classes d'actifs (immobilier, matières premières...).
D'où l'antienne, répétée à l'envi, que FCPI et FIP constituent des outils de diversification du portefeuille, sur une classe d'actif structurellement sous-représentée dans le portefeuille des Français ; en effet les PME représentent près de 65% de l'économie hexagonale, mais moins de 1% des actifs détenus dans le portefeuille des Français.
En quoi se distinguent les FCPI et FIP d'Aurel NextStage ?
Deux points sont à souligner sur nos fonds.
Nous pratiquons le co-investissement entre nos FCPI-FIP et nos FCPR. Ceci veut dire que les particuliers qui investissent dans nos fonds ont accès aux mêmes dossiers d'investissement que les grands investisseurs institutionnels.
Par ailleurs, nous ne proposons que des fonds purs, c'est-à-dire entièrement dédiés à l'investissement dans les PME françaises, principalement non cotées ou cotées sur des marchés dédiés (Marché libre ou Alternext), y compris pour la partie d'investissement libre.
Nous avons une forte conviction sur l'intérêt de cette classe d'actifs pour les investisseurs et ne voulons pas " brouiller " l'intérêt de nos produits en mettant dans nos fonds des OPCVM ou de l'immobilier, déjà très présents dans le portefeuille des français. Ce positionnement nous permet de prendre du recul par rapport à l'optique purement fiscale pour valoriser au mieux et tout au long de l'année ces fonds comme des outils de placements performants.
Propos recueillis par Bernard Le Court
http://www.lesechos.fr/patrimoine/bourse/300118875.htm
Critique de la politique monétaire actuelle de la BCE
Je partage tout à fait le point de vue de Frédéric Leroux, directeur de la gestion des risques chez Carmignac Gestion :
Jeudi 7 décembre à 13h45 : Conseil de politique monétaire de la BCE. Pour décembre, on attend une hausse des taux déjà largement annoncée par Jean-Claude Trichet. Elle devrait intervenir jeudi. Pourtant, il n’y a pas d’inflation en Europe ! De mon point de vue, il s’agit d’essayer de ralentir la croissance du crédit privé qui augmente encore à un rythme de 12-13% l’an, pas forcément pour des raisons purement productives mais aussi spéculatives, notamment sur le marché immobilier. Pour Trichet, cette croissance va trop loin. Le souci, c’est que l’euro devient extrêmement fort par rapport au dollar et au yen. La position concurrentielle des entreprises allemandes à l’exportation s’abîme par rapport à ses concurrentes japonaises. Or, l’industrie allemande contribue aujourd’hui à la croissance européenne grâce à ses exportations. Dans le même temps, des programmes d’augmentations de la fiscalité en Allemagne et l’Italie sont prévus. Continuer d’augmenter les taux alors qu’il n’y a pas d’inflation et que deux des grands pays européens vont augmenter leurs taxations, cela devient un petit peu risqué. Après la hausse attendue jeudi, la BCE devra forcément marquer une pause.
Jeudi 7 décembre à 13h45 : Conseil de politique monétaire de la BCE. Pour décembre, on attend une hausse des taux déjà largement annoncée par Jean-Claude Trichet. Elle devrait intervenir jeudi. Pourtant, il n’y a pas d’inflation en Europe ! De mon point de vue, il s’agit d’essayer de ralentir la croissance du crédit privé qui augmente encore à un rythme de 12-13% l’an, pas forcément pour des raisons purement productives mais aussi spéculatives, notamment sur le marché immobilier. Pour Trichet, cette croissance va trop loin. Le souci, c’est que l’euro devient extrêmement fort par rapport au dollar et au yen. La position concurrentielle des entreprises allemandes à l’exportation s’abîme par rapport à ses concurrentes japonaises. Or, l’industrie allemande contribue aujourd’hui à la croissance européenne grâce à ses exportations. Dans le même temps, des programmes d’augmentations de la fiscalité en Allemagne et l’Italie sont prévus. Continuer d’augmenter les taux alors qu’il n’y a pas d’inflation et que deux des grands pays européens vont augmenter leurs taxations, cela devient un petit peu risqué. Après la hausse attendue jeudi, la BCE devra forcément marquer une pause.
27 novembre 2006
Le PER
Il y a PER et PER
Excellent article des Echos Samedi 25 novembre 2006 :
Le rapport entre le cours et le bénéfice d'une action - le fameux PER - doit être manié avec précaution. Plus que jamais compte tenu de l'évolution des marchés et de leur environnement.
Le ratio cours/bénéfices, le fameux PER (« price earnings ratio »), n'est décidément pas un outil comme les autres. Considéré comme l'épine dorsale de l'analyse financière, ce ratio élémentaire - il se contente de rapporter le cours aux bénéfices courants ou anticipés par action des sociétés cotées -, il se retrouve régulièrement pris au coeur des grands débats financiers.
Abandonné pendant la bulle technologique, malgré les protestations d'une poignée d'investisseurs qui y voyaient un signe tangible de dérive, son retour en force à l'automne 2001 sonnait le retour à la réalité. Au nom de ce même principe de réalité, une partie des gérants exhortent aujourd'hui les investisseurs à prendre leurs distances à l'égard de ce ratio. Craignant une bulle sur les matières premières et les financières, ils l'accusent d'être cette fois-ci le principal vecteur d'illusions, rappelant que le PER n'est pas pertinent pour évaluer des sociétés cycliques. Par essence, les bénéfices augmentent sensiblement lorsque ces secteurs tournent à plein régime, ce qui a pour effet de contracter leurs PER et de donner - abusivement - l'impression que les valorisations sont attrayantes.
Avec l'introduction des nouvelles normes comptables IFRS, le PER s'était aussi trouvé au centre des polémiques. Malgré une plus grande volatilité durant la phase de transition, ce ratio était - à terme - censé être le principal bénéficiaire de ces nouvelles normes, qui, en gommant les particularismes comptables, facilitait les comparaisons sur la base des PER. Actuellement, les professionnels de la gestion n'en sont pas moins partagés sur son impact. Dans le camp des sceptiques, Jérôme Lieury, gérant chez Louvre Gestion, considère que « les normes IFRS ont introduit une plus grande volatilité des résultats, avec en conséquence une plus grande dispersion des prévisions et des consensus, qui impacte les PER et les rendent moins fiables. Aussi réduisent-elles encore un peu plus leur usage aux seules sociétés dont les résultats et les marges sont stables ».
Si tous les gérants reconnaissent au PER le mérite de la simplicité pour valoriser l'avenir d'une société et la comparer à ses concurrents, ils ne lui en trouvent pas moins une multitude de défauts. « Entre autres, il ne rend pas compte de la structure financière », pointe Fabrice Théveneau, directeur général de la recherche actions chez Société Générale. « Par exemple, si une société s'endette pour racheter ses actions, le PER va mécaniquement baisser, donnant l'illusion que la valorisation est attrayante, bien que la qualité du bilan se soit dégradée. »
Alors comment en faire bon usage de ce ratio ? Comme l'explique Vincent Guenzi, responsable de la stratégie d'investissement chez Cholet-Dupont, « le PER reste un excellent instrument pour réaliser un premier tri, même s'il faut dans un deuxième temps l'évaluer au regard d'autres ratios et paramètres tels que la prime de risque. Entre autres, il met en évidence les plus fortes anomalies ou écarts avec le reste du marché. Rhodia, par exemple, se démarque nettement, avec un PER 2006 de 40 fois et de 11 fois selon le consensus. Cette valorisation implique que les investisseurs spéculent sur un redressement de ses résultats futurs et acceptent, en anticipation, de la payer plus chère ».
Outil de pilotage
Prenant le PER pour ce qu'il vaut, les professionnels de la gestion l'utilisent pour relativiser l'attrait des actions par rapport aux obligations, comparant - selon le modèle de la banque centrale américaine, la Fed - l'inverse du PER moyen des actions au rendement des obligations à 10 ans. D'après ce modèle, les marchés d'actions sont chers lorsque le PER est nettement inférieur au rendement des obligations et, inversement, attrayantes lorsque le PER est plus élevé. « Un PER moyen à 15 fois correspond à un niveau correct aujourd'hui, puisqu'il implique un rendement exigé des actions de 6,7 % (l'inverse du ratio cours/bénéfices) qui est attrayant par rapport aux obligations à 10 ans (actuellement à 3,7 %). Par extension, le PER peut servir d'outil de pilotage des portefeuilles. Dès lors que le PER moyen des portefeuilles dépasse 15 fois, il faut procéder à des ajustements et éventuellement prendre des bénéfices, et inversement lorsque le PER moyen descend sous cette barre des 15 fois. »
Mais le principal intérêt du PER est de servir de « mémoire » du marché. Comme le résume Jean-Luc Allain, gérant chez Trusteam Finance, « il s'agit de l'outil sur lequel les données historiques sont les plus complètes pour réaliser des comparaisons. Récemment, mon équipe et moi avons ainsi cherché l'ampleur de la contraction des multiples sur les dix dernières années à l'aide de ce ratio, en comparant les PER du SBF 120 en 1996-1997 avec les prévisions pour la période 2006-2007. Sans surprise, cet examen fait ressortir une revalorisation des sociétés holdings, en particulier d'Eurazeo et de Fimalac dont la décote a fortement baissé, et une contraction des multiples dans les cosmétiques, la pharmacie et la grande distribution. En revanche, ces comparaisons ont mis en évidence ce qui nous semble être des «anomalies» de valorisation dans l'assurance et au cas par cas dans les logiciels et dans les médias ».
Dans l'assurance, le PER moyen d'AXA se situait en effet à 18 fois en 1996-1997 contre 10,5 fois en 2006-2007, tandis que celui d'AGF tournait à 19 fois contre 11,8 fois sur les mêmes périodes. « Cette compression des multiples traduit une défiance du marché après les secousses de 2001 et 2002. Pourtant, la gestion des assureurs s'est nettement améliorée au cours des dernières années. Leurs ratios combinés sont globalement plus élevés et leur rentabilité s'est fortement améliorée grâce aux efforts de restructuration et de réduction des coûts. Aussi l'ampleur de ce «de-rating» ne me paraît pas justifié. »
Dans les logiciels, Jean-Luc Allain isole Dassault Systèmes, dont le PER moyen s'est réduit de 45 fois en 1996-1997 (soit avant les déformations de la bulle technologique) à 23 fois les prévisions 2006-2007, attribuant cette contraction aux mauvais souvenirs de l'an 2000.
Dans les médias, il met en évidence Publicis et SR Téléperformance, dont les PER moyens sont passés respectivement de 19 à 15,5 fois et de 21 à 15,5 fois. « Entre-temps, Publicis est devenu un acteur mondial, ce qui justifierait une prime plus substantielle. Mais le titre a été entraîné dans le sillage des médias, sans raison fondamentale, l'évolution des supports publicitaires devrait même renforcer le poids de Publicis dans son rôle de conseil. Des petites agences spécialisées ont certes pénétré le marché de l'Internet, mais Publicis dispose de ressources financières qui lui permettent, le cas échéant, de procéder à des acquisitions pour renforcer son offre dans ce segment. A ce niveau, le PER actuel donne un signal d'achat assez clair de Publicis. »
NATHALIE OLOF-ORS
Excellent article des Echos Samedi 25 novembre 2006 :
Le rapport entre le cours et le bénéfice d'une action - le fameux PER - doit être manié avec précaution. Plus que jamais compte tenu de l'évolution des marchés et de leur environnement.
Le ratio cours/bénéfices, le fameux PER (« price earnings ratio »), n'est décidément pas un outil comme les autres. Considéré comme l'épine dorsale de l'analyse financière, ce ratio élémentaire - il se contente de rapporter le cours aux bénéfices courants ou anticipés par action des sociétés cotées -, il se retrouve régulièrement pris au coeur des grands débats financiers.
Abandonné pendant la bulle technologique, malgré les protestations d'une poignée d'investisseurs qui y voyaient un signe tangible de dérive, son retour en force à l'automne 2001 sonnait le retour à la réalité. Au nom de ce même principe de réalité, une partie des gérants exhortent aujourd'hui les investisseurs à prendre leurs distances à l'égard de ce ratio. Craignant une bulle sur les matières premières et les financières, ils l'accusent d'être cette fois-ci le principal vecteur d'illusions, rappelant que le PER n'est pas pertinent pour évaluer des sociétés cycliques. Par essence, les bénéfices augmentent sensiblement lorsque ces secteurs tournent à plein régime, ce qui a pour effet de contracter leurs PER et de donner - abusivement - l'impression que les valorisations sont attrayantes.
Avec l'introduction des nouvelles normes comptables IFRS, le PER s'était aussi trouvé au centre des polémiques. Malgré une plus grande volatilité durant la phase de transition, ce ratio était - à terme - censé être le principal bénéficiaire de ces nouvelles normes, qui, en gommant les particularismes comptables, facilitait les comparaisons sur la base des PER. Actuellement, les professionnels de la gestion n'en sont pas moins partagés sur son impact. Dans le camp des sceptiques, Jérôme Lieury, gérant chez Louvre Gestion, considère que « les normes IFRS ont introduit une plus grande volatilité des résultats, avec en conséquence une plus grande dispersion des prévisions et des consensus, qui impacte les PER et les rendent moins fiables. Aussi réduisent-elles encore un peu plus leur usage aux seules sociétés dont les résultats et les marges sont stables ».
Si tous les gérants reconnaissent au PER le mérite de la simplicité pour valoriser l'avenir d'une société et la comparer à ses concurrents, ils ne lui en trouvent pas moins une multitude de défauts. « Entre autres, il ne rend pas compte de la structure financière », pointe Fabrice Théveneau, directeur général de la recherche actions chez Société Générale. « Par exemple, si une société s'endette pour racheter ses actions, le PER va mécaniquement baisser, donnant l'illusion que la valorisation est attrayante, bien que la qualité du bilan se soit dégradée. »
Alors comment en faire bon usage de ce ratio ? Comme l'explique Vincent Guenzi, responsable de la stratégie d'investissement chez Cholet-Dupont, « le PER reste un excellent instrument pour réaliser un premier tri, même s'il faut dans un deuxième temps l'évaluer au regard d'autres ratios et paramètres tels que la prime de risque. Entre autres, il met en évidence les plus fortes anomalies ou écarts avec le reste du marché. Rhodia, par exemple, se démarque nettement, avec un PER 2006 de 40 fois et de 11 fois selon le consensus. Cette valorisation implique que les investisseurs spéculent sur un redressement de ses résultats futurs et acceptent, en anticipation, de la payer plus chère ».
Outil de pilotage
Prenant le PER pour ce qu'il vaut, les professionnels de la gestion l'utilisent pour relativiser l'attrait des actions par rapport aux obligations, comparant - selon le modèle de la banque centrale américaine, la Fed - l'inverse du PER moyen des actions au rendement des obligations à 10 ans. D'après ce modèle, les marchés d'actions sont chers lorsque le PER est nettement inférieur au rendement des obligations et, inversement, attrayantes lorsque le PER est plus élevé. « Un PER moyen à 15 fois correspond à un niveau correct aujourd'hui, puisqu'il implique un rendement exigé des actions de 6,7 % (l'inverse du ratio cours/bénéfices) qui est attrayant par rapport aux obligations à 10 ans (actuellement à 3,7 %). Par extension, le PER peut servir d'outil de pilotage des portefeuilles. Dès lors que le PER moyen des portefeuilles dépasse 15 fois, il faut procéder à des ajustements et éventuellement prendre des bénéfices, et inversement lorsque le PER moyen descend sous cette barre des 15 fois. »
Mais le principal intérêt du PER est de servir de « mémoire » du marché. Comme le résume Jean-Luc Allain, gérant chez Trusteam Finance, « il s'agit de l'outil sur lequel les données historiques sont les plus complètes pour réaliser des comparaisons. Récemment, mon équipe et moi avons ainsi cherché l'ampleur de la contraction des multiples sur les dix dernières années à l'aide de ce ratio, en comparant les PER du SBF 120 en 1996-1997 avec les prévisions pour la période 2006-2007. Sans surprise, cet examen fait ressortir une revalorisation des sociétés holdings, en particulier d'Eurazeo et de Fimalac dont la décote a fortement baissé, et une contraction des multiples dans les cosmétiques, la pharmacie et la grande distribution. En revanche, ces comparaisons ont mis en évidence ce qui nous semble être des «anomalies» de valorisation dans l'assurance et au cas par cas dans les logiciels et dans les médias ».
Dans l'assurance, le PER moyen d'AXA se situait en effet à 18 fois en 1996-1997 contre 10,5 fois en 2006-2007, tandis que celui d'AGF tournait à 19 fois contre 11,8 fois sur les mêmes périodes. « Cette compression des multiples traduit une défiance du marché après les secousses de 2001 et 2002. Pourtant, la gestion des assureurs s'est nettement améliorée au cours des dernières années. Leurs ratios combinés sont globalement plus élevés et leur rentabilité s'est fortement améliorée grâce aux efforts de restructuration et de réduction des coûts. Aussi l'ampleur de ce «de-rating» ne me paraît pas justifié. »
Dans les logiciels, Jean-Luc Allain isole Dassault Systèmes, dont le PER moyen s'est réduit de 45 fois en 1996-1997 (soit avant les déformations de la bulle technologique) à 23 fois les prévisions 2006-2007, attribuant cette contraction aux mauvais souvenirs de l'an 2000.
Dans les médias, il met en évidence Publicis et SR Téléperformance, dont les PER moyens sont passés respectivement de 19 à 15,5 fois et de 21 à 15,5 fois. « Entre-temps, Publicis est devenu un acteur mondial, ce qui justifierait une prime plus substantielle. Mais le titre a été entraîné dans le sillage des médias, sans raison fondamentale, l'évolution des supports publicitaires devrait même renforcer le poids de Publicis dans son rôle de conseil. Des petites agences spécialisées ont certes pénétré le marché de l'Internet, mais Publicis dispose de ressources financières qui lui permettent, le cas échéant, de procéder à des acquisitions pour renforcer son offre dans ce segment. A ce niveau, le PER actuel donne un signal d'achat assez clair de Publicis. »
NATHALIE OLOF-ORS
21 novembre 2006
28 règles de trading de William Delbert Gann
Ci-dessous sont énoncés les 28 règles de trading de William Delbert Gann, célèbre
trader américain. Elles sont extraites de son livre: "How to make profits in
commodities".
1. Capital nécessaire: Divisez votre capital en 10 parts égales et ne risquez jamais
plus d'un dixième de votre capital sur un trade.
2. Utilisez des ordres "stop-loss". Quand vous passez un ordre sur le marché, pensez
toujours à le protéger avec un ordre " stop-loss ".
3. N'exécutez pas un trop grand nombre d'opérations. Vous seriez en contradiction avec les règles de préservation du capital.
4. Ne laissez jamais un profit de transformer en perte. Lorsque vous avez réalisé un
profit (...), remontez votre ordre stop de façon à ne pas perdre d'argent.
5. N'allez pas contre la tendance. Vous ne devez ni acheter ni vendre si vous n'êtes
pas sûr d'avoir détecté la tendance à l'aide de vos graphiques et de vos d'analyses.
6. Si vous avez des doutes, sortez du marché et n'y entrez pas si vous n'arrivez pas à déterminer la tendance.
7. Traitez seulement les marchés liquides et actifs. Laissez de côté les marchés peu
actifs et peu liquides.
8. Répartissez le risque. Faites des opérations sur deux ou trois matières premières.
Ne mettez pas tout votre capital sur une seule d'entre elles.
9. Ne limitez pas vos ordres ne passez pas d'ordre d'achat ou de vente à cours limité. Passez vos ordres au prix du marché.
10. Ne clôturez pas une position sans avoir une bonne raison. Remontez plutôt votre
stop suiveur afin de protéger vos profits.
11. Mettez de l’argent de côté. Lorsque vous réalisez une série de trades gagnants,
mettez de l'argent de côté sur un compte bancaire et vous l'utiliserez en cas
d'urgence.
12. Vous ne devez jamais acheter ou vendre uniquement pour réaliser un profit très
faible.
13. Ne moyennez jamais à la baisse. C'est la pire erreur qu'un trader puisse
commettre.
14. Ne clôturez pas une position parce que vous n'avez pas la patience d'attendre,
n'entrez pas non plus sur le marché parce que vous êtes pressé d'agir.
15. Evitez les petits gains et les lourdes pertes.
16. N'annulez jamais un ordre stop. Vous avez passé votre ordre stop en même temps que votre ordre d'achat ou de vente, alors conservez le.
17. Evitez de rentrer et sortir du marché trop souvent.
18. N'hésitez pas à vendre à découvert. Ce qu'il vous faut c'est suivre la tendance et gagner de l'argent.
19. N’achetez pas uniquement parce que vous pensez que le prix est bas. Ne vendez pas
à découvert uniquement parce que vous pensez que le prix est haut.
20. Soyez prudent et ne "pyramidez" pas au mauvais moment. Attendez que le marché soit très actif et qu'il ait dépassé un niveau de résistance avant de renforcer vos
positions par de nouveaux achats et attendez qu'il ait franchi une zone de résistance
avant de prendre d'autres positions vendeuses.
21. Soyez sélectifs, pour acheter choisissez les marchés qui ont une forte tendance
haussière et pour vendre à découvert choisissez ceux qui suivent une forte tendance
baissière.
22. Traitez chaque matière première séparément. Si vous êtes long sur une matière
première et qu'elle commence à baisser, n'en vendez pas une autre à découvert pour
compenser vos pertes. Débouclez votre position; "prenez vos pertes" et attendez une
autre opportunité.
23. Ne changez pas d'avis sans avoir une bonne raison. Quand vous passez un ordre sur
le marché, faites le en suivant les règles que vous vous êtes fixées ou pour toute
autre raison valable, mais ne débouclez pas votre position s'il n'y a pas de
changement de tendance.
24. Evitez d’augmenter vos mises après une longue période de gains ou de trades gagnants.
25. N'essayez pas de deviner si le marché a réalisé un sommet ou un bas, attendez que
le marché montre réellement qu'il a réalisé un sommet ou un bas.
26. Ne suivez pas l'avis d'autrui, sauf si êtes sûr que cette personne s'y connaît
mieux que vous.
27. Réduisez votre mise dès la première perte, ne l'augmentez jamais.
28. Evitez d'entrer et de sortir du marché au mauvais moment; évitez aussi d'y rentrer au bon moment mais d'en sortir à quand il ne faudrait pas; cela constituerait une double erreur.
trader américain. Elles sont extraites de son livre: "How to make profits in
commodities".
1. Capital nécessaire: Divisez votre capital en 10 parts égales et ne risquez jamais
plus d'un dixième de votre capital sur un trade.
2. Utilisez des ordres "stop-loss". Quand vous passez un ordre sur le marché, pensez
toujours à le protéger avec un ordre " stop-loss ".
3. N'exécutez pas un trop grand nombre d'opérations. Vous seriez en contradiction avec les règles de préservation du capital.
4. Ne laissez jamais un profit de transformer en perte. Lorsque vous avez réalisé un
profit (...), remontez votre ordre stop de façon à ne pas perdre d'argent.
5. N'allez pas contre la tendance. Vous ne devez ni acheter ni vendre si vous n'êtes
pas sûr d'avoir détecté la tendance à l'aide de vos graphiques et de vos d'analyses.
6. Si vous avez des doutes, sortez du marché et n'y entrez pas si vous n'arrivez pas à déterminer la tendance.
7. Traitez seulement les marchés liquides et actifs. Laissez de côté les marchés peu
actifs et peu liquides.
8. Répartissez le risque. Faites des opérations sur deux ou trois matières premières.
Ne mettez pas tout votre capital sur une seule d'entre elles.
9. Ne limitez pas vos ordres ne passez pas d'ordre d'achat ou de vente à cours limité. Passez vos ordres au prix du marché.
10. Ne clôturez pas une position sans avoir une bonne raison. Remontez plutôt votre
stop suiveur afin de protéger vos profits.
11. Mettez de l’argent de côté. Lorsque vous réalisez une série de trades gagnants,
mettez de l'argent de côté sur un compte bancaire et vous l'utiliserez en cas
d'urgence.
12. Vous ne devez jamais acheter ou vendre uniquement pour réaliser un profit très
faible.
13. Ne moyennez jamais à la baisse. C'est la pire erreur qu'un trader puisse
commettre.
14. Ne clôturez pas une position parce que vous n'avez pas la patience d'attendre,
n'entrez pas non plus sur le marché parce que vous êtes pressé d'agir.
15. Evitez les petits gains et les lourdes pertes.
16. N'annulez jamais un ordre stop. Vous avez passé votre ordre stop en même temps que votre ordre d'achat ou de vente, alors conservez le.
17. Evitez de rentrer et sortir du marché trop souvent.
18. N'hésitez pas à vendre à découvert. Ce qu'il vous faut c'est suivre la tendance et gagner de l'argent.
19. N’achetez pas uniquement parce que vous pensez que le prix est bas. Ne vendez pas
à découvert uniquement parce que vous pensez que le prix est haut.
20. Soyez prudent et ne "pyramidez" pas au mauvais moment. Attendez que le marché soit très actif et qu'il ait dépassé un niveau de résistance avant de renforcer vos
positions par de nouveaux achats et attendez qu'il ait franchi une zone de résistance
avant de prendre d'autres positions vendeuses.
21. Soyez sélectifs, pour acheter choisissez les marchés qui ont une forte tendance
haussière et pour vendre à découvert choisissez ceux qui suivent une forte tendance
baissière.
22. Traitez chaque matière première séparément. Si vous êtes long sur une matière
première et qu'elle commence à baisser, n'en vendez pas une autre à découvert pour
compenser vos pertes. Débouclez votre position; "prenez vos pertes" et attendez une
autre opportunité.
23. Ne changez pas d'avis sans avoir une bonne raison. Quand vous passez un ordre sur
le marché, faites le en suivant les règles que vous vous êtes fixées ou pour toute
autre raison valable, mais ne débouclez pas votre position s'il n'y a pas de
changement de tendance.
24. Evitez d’augmenter vos mises après une longue période de gains ou de trades gagnants.
25. N'essayez pas de deviner si le marché a réalisé un sommet ou un bas, attendez que
le marché montre réellement qu'il a réalisé un sommet ou un bas.
26. Ne suivez pas l'avis d'autrui, sauf si êtes sûr que cette personne s'y connaît
mieux que vous.
27. Réduisez votre mise dès la première perte, ne l'augmentez jamais.
28. Evitez d'entrer et de sortir du marché au mauvais moment; évitez aussi d'y rentrer au bon moment mais d'en sortir à quand il ne faudrait pas; cela constituerait une double erreur.
19 novembre 2006
Graphiques historiques de la bourse américaine
L'histoire des krachs boursiers peut être visualisée rapidement à l'aide des graphiques faits par stockcharts. http://stockcharts.com/charts/historical/
On voit même le parcours du Dow Jones en remontant jusqu'à 1900. C'est impressionnant. En suivant, les différentes courbes, on se rend compte par exemple à quel point le krach de 1929 a pu acculer à la ruine total tout le système économique américain et international :
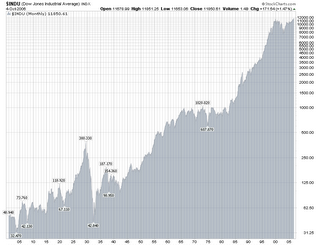


On voit même le parcours du Dow Jones en remontant jusqu'à 1900. C'est impressionnant. En suivant, les différentes courbes, on se rend compte par exemple à quel point le krach de 1929 a pu acculer à la ruine total tout le système économique américain et international :
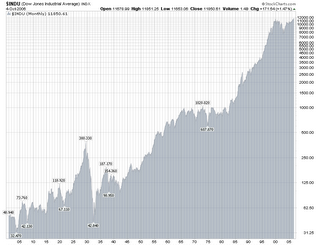


17 novembre 2006
stratégie d'investissement en bourse
Voilà un blog bien argumenté et très intéressant sur le sujet par Forcast : http://forcast.canalblog.com/
Je me permets de reprendre un article publié à l'origine sur le forum SICAV de Boursorama.
Démêler les anomalies du marché boursier (j.roger5)
La valeur génère de meilleurs rendements que la taille de l’entreprise ou le momentum du titre
Demandez à un économiste financier ce que ça signifie quand un titre perd la moitié de sa valeur sur le marché boursier. Il vous répondra que c’est un titre qui est devenu deux fois plus risqué. Une action, dira-t-il, ne perd pas la moitié de sa valeur pour rien. C’est le signe que la compagnie affronte de nouveaux obstacles qui rendent son avenir (et ses bénéfices) plus périlleux ou plus aléatoire.
Demandez maintenant à Warren Buffett ce que ça veut dire quand un titre perd la moitié de sa valeur. Il vous répondra, comme il a déjà eu l’occasion de le faire, qu’il n’est pas deux fois plus risqué, mais tout simplement deux fois plus attrayant.
Ces deux opinions en apparence divergentes évoquent dans mon esprit l’image du verre à moitié vide et à moitié plein. Il est bien possible, en effet, qu’une nouvelle information au sujet d’une entreprise augmente la probabilité que ses profits futurs soient deux fois moins élevés que prévu. Mais il est bien possible aussi que cette nouvelle information ne soit qu’une menace temporaire, exagérée, voire non fondée, mais une menace quand même. Qui a raison ? Qui a tort ? Bien difficile de le dire.
Les investisseurs, tel Warren Buffett, recherchent les aubaines, c’est-à-dire les titres qui se vendent à des multiples cours/bénéfices (C/B) ou cours/valeur comptable (V/VC) inférieurs à la moyenne des titres de leur secteur ou, mieux encore, inférieurs à leur moyenne historique. Et ils ont raison de le faire car le rendement des titres qui ont de bas ratios C/VC est bien supérieur à ceux qui ont de hauts ratios C/VC. La valeur ajoutée des titres à bas ratios C/VC aux Etats-Unis, entre 1926 et 1997, a été de 0,43 % par mois. Ce qui représente un rendement additionnel de plus de 5 % sur une base annuelle. Les économistes financiers vous diront que cette prime n’est pas gratuite, ne serait-ce que parce que les entreprises qui ont un bas ratio C/VC ont plus de chances de faire faillite que les entreprises qui ont un haut ratio C/VC.
Ce qu’on a appelé « l’effet valeur » n’est pas la seule opportunité intéressante des marchés financiers. Deux autres opportunités, moins constantes et moins payantes toutefois, ont donné lieu à des centaines d’articles académiques et de thèses de doctorat : l’effet taille d’une part, et l’effet momentum d’autre part.
Les entreprises de très petite taille ont démontré depuis longtemps leur capacité à générer un meilleur rendement que les entreprises de grande taille. La valeur ajoutée de l’effet taille, entre 1926 et 1997, a été de 0,20 % par mois, ou 6 % de gain net supplémentaire par année.
Les actions qui gagnent de la valeur depuis un an performent nettement mieux, l’année suivante, que les actions qui ont baissé de valeur lors de la même période. En d’autres termes, il est préférable d’acheter ce qui monte que ce qui baisse. C’est ce qu’on a appelé l’effet momentum. En fait, tout ce qui monte beaucoup depuis 3, 6 et 12 mois a tendance à faire mieux que le marché lors des 3, 6 et 12 mois suivants. Au-delà d’un horizon de 12 mois et en bas d’un horizon de 3 mois, il n’y a pratiquement rien à gagner de significatif.
Les chercheurs s’entendent habituellement pour dire que l’effet valeur est le plus important des trois, dans la mesure où il permet d’obtenir des rendements supérieurs à ceux générés par l’effet taille et l’effet momentum. Et la taille des entreprises, selon certains, serait un élément plus important que l’effet momentum. Il est toutefois assez difficile d’établir l’effet net, indépendant de tout autre facteur, des trois anomalies de marché sur le rendement du portefeuille, car elles sont relativement imbriquées l’une dans l’autre.
Par exemple, les titres qui font partie du 10 % des entreprises les plus petites du marché en termes de capitalisation boursière (le 10e décile disons) comportent une bonne part de compagnies qui ont subi une forte correction sur le marché, les faisant ainsi passer du 8e ou 9e décile, au 10e décile. Quand on mesure la taille des compagnies selon le critère de la capitalisation boursière, il est facile de comprendre qu’un titre qui subit une correction boursière de 50 % voit sa capitalisation boursière, et donc sa taille, chuter de 50 %.
Pour contourner ce problème, certains chercheurs comme Robert Arnott ont choisi de mesurer la taille des entreprises selon leur chiffre de vente ou leur valeur comptable, plutôt qu’en fonction de leur capitalisation boursière, de sorte que le prix de l’action n’intervient pas dans la mesure de la taille des entreprises. Résultat : le rendement excédentaire de l’effet taille chute de deux tiers. En d’autres termes, la valeur ajoutée de l’effet taille n’est pas de 6 % par année mais de 2 %.
Réciproquement, c’est l’effet valeur qui est beaucoup plus important (trois fois plus) que ce qu’on croyait quand on l’isole correctement de la taille des entreprises mesurées selon la capitalisation boursière. Pour les gestionnaires de portefeuille qui peuvent se permettre d’investir dans ce créneau, la stratégie la plus lucrative reste quand même celle des très petites entreprises ayant un ratio cours/valeur comptable inférieur à 1.
Comprendre le momentum
Le questionnement du milieu académique sur l’effet momentum n’est pas tout à fait du même ordre que celui sur l’effet taille ou l’effet valeur. La grande question qui préoccupe les chercheurs depuis quelques années est celle de savoir si le momentum est lié ou non aux rendements des différents secteurs industriels.
On sait très bien que les écarts de rendement entre les grands secteurs sont considérables. Pendant que certaines industries ont le vent dans les voiles (c’est le cas depuis quelques temps du pétrole, des métaux, des banques, etc.), d’autres vivent des heures difficiles (cas actuel des pharmaceutiques, papetières, imprimeries, technos, etc.). Dans ces conditions, pour capter l’effet momentum, faut-il nécessairement sur-pondérer son portefeuille dans certains secteurs, et le sous-pondérer dans d’autres ?
Pour l’heure, il n’y a pas de consensus entre les chercheurs. Certains croient qu’on peut profiter d’un effet momentum en ciblant des titres seulement, sans se préoccuper de leur secteur, d’autres pensent plutôt que l’effet momentum consiste d’abord à rechercher les secteurs qui marchent, et ensuite les meilleures entreprises qui composent ces secteurs.
Une étude récente de Alan Scowcroft et James Sefton, couvant la période 1980-2003, coupe la poire en deux. Pour l’univers des grandes capitalisations à l’échelle mondiale, l’effet momemtum est surtout une question d’industrie, tandis que dans l’univers des petites capitalisations, aux Etats-Unis notamment, l’effet momentum se trouve au niveau des compagnies en particulier, sans égard à leur secteur.
L’explication de ce phénomène, selon les deux chercheurs, serait redevable au processus de diffusion des nouvelles pour les grandes et petites entreprises, qui n’est pas le même de part et d’autre. Ainsi, quand une grande entreprise annonce des profits plus élevés que prévus sur un trimestre, la nouvelle a beaucoup de chance d’être interprétée comme une amélioration des affaires pour toutes les grandes compagnies du même secteur. Que Exxon annonce des profits supérieurs aux anticipations des analystes, les chances sont bonnes que les actions de Petro-Canada, Shell et BP profitent également de la nouvelle. Cette réaction est normale quand on sait à quel point les investisseurs ont de la difficulté à distinguer les améliorations dans une industrie entière de celles qui concernent une entreprise en particulier.
Dans le cas des petites entreprises, les investisseurs ont le sentiment que leur performance financière est plus une question de gestion interne, de gouvernance et de stratégies de pénétration de marché que de cycles économiques ou des aléas dans chacune des industries. Le momentum d’un titre de small cap se poursuivra tant que des signaux à l’intérieur de l’entreprise elle-même confirmeront que les affaires vont mieux que prévu.
Pour les investisseurs qui accordent un certain crédit à la recherche académique et qui ne gèrent pas des milliards de dollars, la meilleure stratégie consiste sans doute à investir dans les titres de petites capitalisations qui constituent de bonnes aubaines en termes de ratio cours/valeur comptable (C/VC < 1), et dont l’action connaît un bon momentum depuis 6 à 12 mois. Bref, il s’agit de combiner, en une seule et même stratégie, les trois plus importants « effets boursiers » découverts par la finance moderne. C’est comme d’avoir le beurre, l’argent du beurre… et la beurrière.
André Gosselin, vice-président recherche, Orientation Finance
Références :
Robert Arnott, « Disentangling size and value », Financial Analysts Journal, septembre/octobre 2005, p. 12-15.
Alan Scowcroft et James Sefton, “Understanding momentum”, Financial Analysts Journal, mars/avril 2005, p. 64-82.
Je me permets de reprendre un article publié à l'origine sur le forum SICAV de Boursorama.
Démêler les anomalies du marché boursier (j.roger5)
La valeur génère de meilleurs rendements que la taille de l’entreprise ou le momentum du titre
Demandez à un économiste financier ce que ça signifie quand un titre perd la moitié de sa valeur sur le marché boursier. Il vous répondra que c’est un titre qui est devenu deux fois plus risqué. Une action, dira-t-il, ne perd pas la moitié de sa valeur pour rien. C’est le signe que la compagnie affronte de nouveaux obstacles qui rendent son avenir (et ses bénéfices) plus périlleux ou plus aléatoire.
Demandez maintenant à Warren Buffett ce que ça veut dire quand un titre perd la moitié de sa valeur. Il vous répondra, comme il a déjà eu l’occasion de le faire, qu’il n’est pas deux fois plus risqué, mais tout simplement deux fois plus attrayant.
Ces deux opinions en apparence divergentes évoquent dans mon esprit l’image du verre à moitié vide et à moitié plein. Il est bien possible, en effet, qu’une nouvelle information au sujet d’une entreprise augmente la probabilité que ses profits futurs soient deux fois moins élevés que prévu. Mais il est bien possible aussi que cette nouvelle information ne soit qu’une menace temporaire, exagérée, voire non fondée, mais une menace quand même. Qui a raison ? Qui a tort ? Bien difficile de le dire.
Les investisseurs, tel Warren Buffett, recherchent les aubaines, c’est-à-dire les titres qui se vendent à des multiples cours/bénéfices (C/B) ou cours/valeur comptable (V/VC) inférieurs à la moyenne des titres de leur secteur ou, mieux encore, inférieurs à leur moyenne historique. Et ils ont raison de le faire car le rendement des titres qui ont de bas ratios C/VC est bien supérieur à ceux qui ont de hauts ratios C/VC. La valeur ajoutée des titres à bas ratios C/VC aux Etats-Unis, entre 1926 et 1997, a été de 0,43 % par mois. Ce qui représente un rendement additionnel de plus de 5 % sur une base annuelle. Les économistes financiers vous diront que cette prime n’est pas gratuite, ne serait-ce que parce que les entreprises qui ont un bas ratio C/VC ont plus de chances de faire faillite que les entreprises qui ont un haut ratio C/VC.
Ce qu’on a appelé « l’effet valeur » n’est pas la seule opportunité intéressante des marchés financiers. Deux autres opportunités, moins constantes et moins payantes toutefois, ont donné lieu à des centaines d’articles académiques et de thèses de doctorat : l’effet taille d’une part, et l’effet momentum d’autre part.
Les entreprises de très petite taille ont démontré depuis longtemps leur capacité à générer un meilleur rendement que les entreprises de grande taille. La valeur ajoutée de l’effet taille, entre 1926 et 1997, a été de 0,20 % par mois, ou 6 % de gain net supplémentaire par année.
Les actions qui gagnent de la valeur depuis un an performent nettement mieux, l’année suivante, que les actions qui ont baissé de valeur lors de la même période. En d’autres termes, il est préférable d’acheter ce qui monte que ce qui baisse. C’est ce qu’on a appelé l’effet momentum. En fait, tout ce qui monte beaucoup depuis 3, 6 et 12 mois a tendance à faire mieux que le marché lors des 3, 6 et 12 mois suivants. Au-delà d’un horizon de 12 mois et en bas d’un horizon de 3 mois, il n’y a pratiquement rien à gagner de significatif.
Les chercheurs s’entendent habituellement pour dire que l’effet valeur est le plus important des trois, dans la mesure où il permet d’obtenir des rendements supérieurs à ceux générés par l’effet taille et l’effet momentum. Et la taille des entreprises, selon certains, serait un élément plus important que l’effet momentum. Il est toutefois assez difficile d’établir l’effet net, indépendant de tout autre facteur, des trois anomalies de marché sur le rendement du portefeuille, car elles sont relativement imbriquées l’une dans l’autre.
Par exemple, les titres qui font partie du 10 % des entreprises les plus petites du marché en termes de capitalisation boursière (le 10e décile disons) comportent une bonne part de compagnies qui ont subi une forte correction sur le marché, les faisant ainsi passer du 8e ou 9e décile, au 10e décile. Quand on mesure la taille des compagnies selon le critère de la capitalisation boursière, il est facile de comprendre qu’un titre qui subit une correction boursière de 50 % voit sa capitalisation boursière, et donc sa taille, chuter de 50 %.
Pour contourner ce problème, certains chercheurs comme Robert Arnott ont choisi de mesurer la taille des entreprises selon leur chiffre de vente ou leur valeur comptable, plutôt qu’en fonction de leur capitalisation boursière, de sorte que le prix de l’action n’intervient pas dans la mesure de la taille des entreprises. Résultat : le rendement excédentaire de l’effet taille chute de deux tiers. En d’autres termes, la valeur ajoutée de l’effet taille n’est pas de 6 % par année mais de 2 %.
Réciproquement, c’est l’effet valeur qui est beaucoup plus important (trois fois plus) que ce qu’on croyait quand on l’isole correctement de la taille des entreprises mesurées selon la capitalisation boursière. Pour les gestionnaires de portefeuille qui peuvent se permettre d’investir dans ce créneau, la stratégie la plus lucrative reste quand même celle des très petites entreprises ayant un ratio cours/valeur comptable inférieur à 1.
Comprendre le momentum
Le questionnement du milieu académique sur l’effet momentum n’est pas tout à fait du même ordre que celui sur l’effet taille ou l’effet valeur. La grande question qui préoccupe les chercheurs depuis quelques années est celle de savoir si le momentum est lié ou non aux rendements des différents secteurs industriels.
On sait très bien que les écarts de rendement entre les grands secteurs sont considérables. Pendant que certaines industries ont le vent dans les voiles (c’est le cas depuis quelques temps du pétrole, des métaux, des banques, etc.), d’autres vivent des heures difficiles (cas actuel des pharmaceutiques, papetières, imprimeries, technos, etc.). Dans ces conditions, pour capter l’effet momentum, faut-il nécessairement sur-pondérer son portefeuille dans certains secteurs, et le sous-pondérer dans d’autres ?
Pour l’heure, il n’y a pas de consensus entre les chercheurs. Certains croient qu’on peut profiter d’un effet momentum en ciblant des titres seulement, sans se préoccuper de leur secteur, d’autres pensent plutôt que l’effet momentum consiste d’abord à rechercher les secteurs qui marchent, et ensuite les meilleures entreprises qui composent ces secteurs.
Une étude récente de Alan Scowcroft et James Sefton, couvant la période 1980-2003, coupe la poire en deux. Pour l’univers des grandes capitalisations à l’échelle mondiale, l’effet momemtum est surtout une question d’industrie, tandis que dans l’univers des petites capitalisations, aux Etats-Unis notamment, l’effet momentum se trouve au niveau des compagnies en particulier, sans égard à leur secteur.
L’explication de ce phénomène, selon les deux chercheurs, serait redevable au processus de diffusion des nouvelles pour les grandes et petites entreprises, qui n’est pas le même de part et d’autre. Ainsi, quand une grande entreprise annonce des profits plus élevés que prévus sur un trimestre, la nouvelle a beaucoup de chance d’être interprétée comme une amélioration des affaires pour toutes les grandes compagnies du même secteur. Que Exxon annonce des profits supérieurs aux anticipations des analystes, les chances sont bonnes que les actions de Petro-Canada, Shell et BP profitent également de la nouvelle. Cette réaction est normale quand on sait à quel point les investisseurs ont de la difficulté à distinguer les améliorations dans une industrie entière de celles qui concernent une entreprise en particulier.
Dans le cas des petites entreprises, les investisseurs ont le sentiment que leur performance financière est plus une question de gestion interne, de gouvernance et de stratégies de pénétration de marché que de cycles économiques ou des aléas dans chacune des industries. Le momentum d’un titre de small cap se poursuivra tant que des signaux à l’intérieur de l’entreprise elle-même confirmeront que les affaires vont mieux que prévu.
Pour les investisseurs qui accordent un certain crédit à la recherche académique et qui ne gèrent pas des milliards de dollars, la meilleure stratégie consiste sans doute à investir dans les titres de petites capitalisations qui constituent de bonnes aubaines en termes de ratio cours/valeur comptable (C/VC < 1), et dont l’action connaît un bon momentum depuis 6 à 12 mois. Bref, il s’agit de combiner, en une seule et même stratégie, les trois plus importants « effets boursiers » découverts par la finance moderne. C’est comme d’avoir le beurre, l’argent du beurre… et la beurrière.
André Gosselin, vice-président recherche, Orientation Finance
Références :
Robert Arnott, « Disentangling size and value », Financial Analysts Journal, septembre/octobre 2005, p. 12-15.
Alan Scowcroft et James Sefton, “Understanding momentum”, Financial Analysts Journal, mars/avril 2005, p. 64-82.
Inscription à :
Commentaires (Atom)